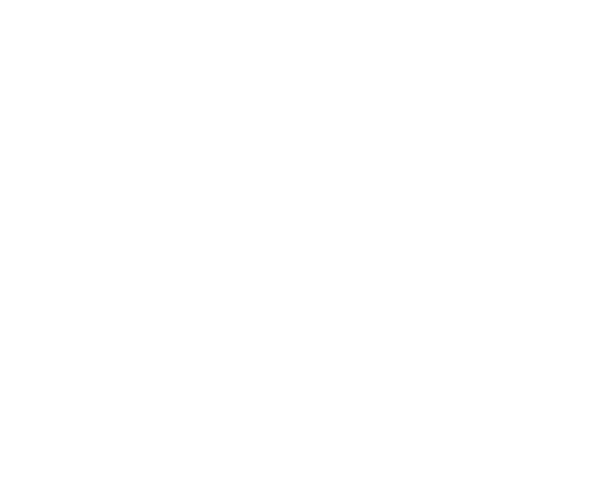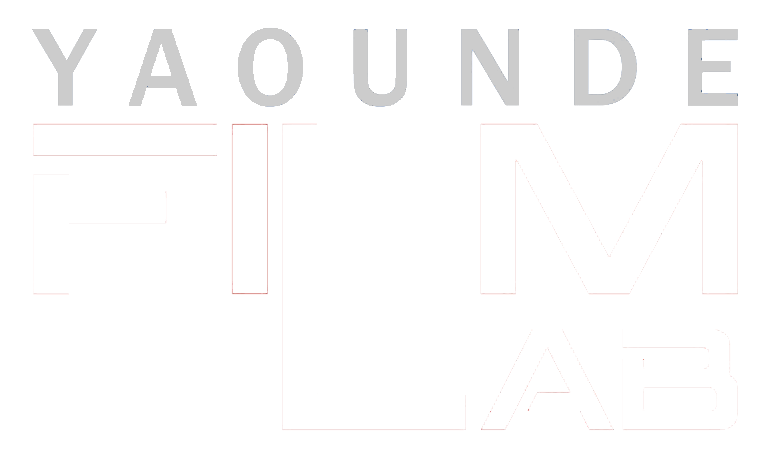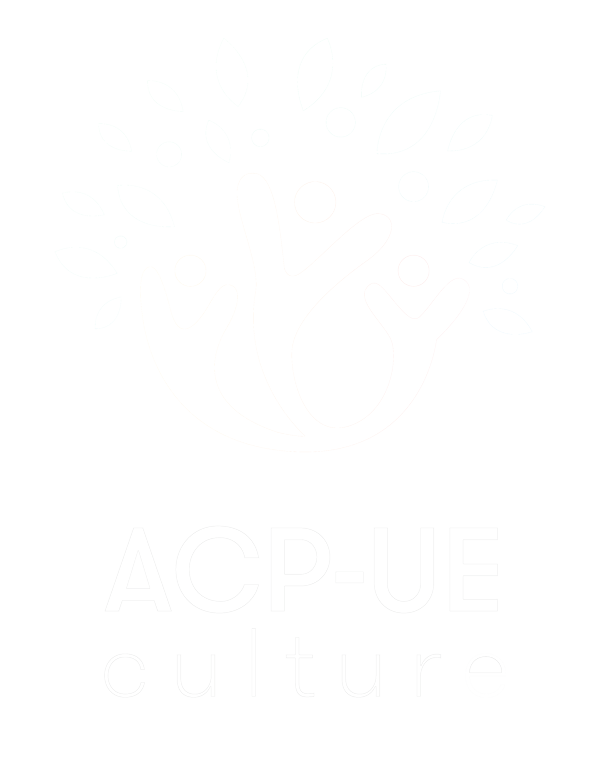Sorry, translation under way.
Couleur Coton raconte l’histoire des membres d’une famille rurale du Burkina Faso, une famille de cotonculteurs depuis plusieurs générations. C’est l’histoire de Pascal Ganou, père, mais aussi grand-père qui s’investit dans cette activité qui est la seule qu’il connait depuis sa tendre enfance et qui le définit plus que tout autre chose dans sa vie. Ses femmes et la plupart de ses enfants ne se posent pas plus de questions que lui sur cette activité qui les nourrit tant bien que mal. Ils sont dans un fatalisme qui conçoit que la vie ne puisse pas être généreuse pour tout le monde. Pourtant une de ses filles l’obligera à faire évoluer sa vision des choses, à prendre conscience… C’est l’histoire de Balkissa, fille de Pascal qui fait des études universitaires. Elle écrit en vue d’être éditée. Elle est très lucide sur la situation des cotonculteurs ouestafricains, victimes d’un système d’accaparation. Balkissa est lucide sur la question, trop peut-être ? Elle se laisse tenter par des théories complotistes et anti-françaises servies sur le net. Mais, même en nourrissant un sentiment anti-francais, elle se consacre à trouver son visa, l’homme par qui arrivera sa délivrance. Elle est de toutes les luttes et manifestations politiques. Son pays est encore en effervescence, deux coups d’État s’y sont passés en 2022, et rien n’y encore garantit une stabilité minime. Quant au cousin germain Lamine, la vente de la fripe est sa soupape de sécurité. Cet autre secteur d’activité incarné par le jeune vendeur ambulant révèle un parcours similaire au coton : il a vu le jour pour servir de débouché aux vêtements portés et déclassés de l’Occident, il a eu ses beaux jours, il est en péril avec le nouvel impérialisme commercial chinois, et là encore, le gouvernement regarde ailleurs. Mais depuis 2015, les gouvernements du pays se sont enchaînés au rythme des coups d’États alors même que le terrorisme gangrène progressivement le pays. Chacun de mes protagonistes tente de rester debout à sa façon, pendant que la culture du coton tisse leur vie au quotidien.
Director's note
Sorry, translation under way.
« Couleur coton» est l’histoire du coton ouest africain, cultivé au Burkina Faso, au Mali, en Côte d’ivoire, au Bénin ou encore au Tchad … Celui-ci est transporté en Asie pour être transformé. Il repartira en Occident pour être porté avant de revenir sous forme de fripes sur sa terre de production. Quand l’Occident se débarrasse de ses vêtements usagers dans les bennes Emmaüs, contrairement à ce que croit le généreux donateur, ce vêtement ne sera pas offert aux pauvres africains qui ne s’auto-suffissent jamais… Il sera vendu aux cotonculteurs qui en ont produit la matière première. Burkina Faso. Une terre de production qui ne transforme pas, qui ne transforme plus son or blanc depuis l’assassinat du président Thomas Sankara qui en avait pourtant fait une priorité. Il aura au prix de sa vie, tenté vainement d’extirper le sort des matières premières de son pays à cette main invisible qui presse le continent depuis des siècles. Cette main invisible nommée « économie de marché ». Cette loi fauve par laquelle « les faibles sont la nourriture dont les forts se nourrissent ». Cette loi sans foi qui fait du continent un festin auquel est conviée les moins partageurs, les plus carnassiers, les plus dévoués aux places boursières ventrues qui ont dressé la table depuis l’esclavage. Depuis les colonisations, depuis les nouveaux termes du commerce mondial… Le coton n’est pas une plante qui poussait naturellement sur les terres ouestafricaines. En effet, elle est gourmande en eau, qui y fait défaut. Elle est encore plus gourmande en nutriments, et les terres d’Afrique sub-sahariennes ne sont pas riches. Alors après tant de décennies d’exploitation, cette plante gourmande a appauvri et asséchées drastiquement les terres agricoles. Alors comment et pourquoi cette plante est-elle devenue l’une des principales cultures de tant de pays ? Dans l’histoire commune que partagent l’Afrique et l’Occident, des esclaves étaient sur 2 5
pris en Afrique et amenés en Amérique pour entre-autre cultiver du coton dans les plantations. A l’abolition de l’esclavage, l’industrie textile occidentale ayant encore besoin de coton, doit trouver des solutions pour en produire. Après une longue phase transitoire, un constat simple fait rebattre les cartes : s’il n’est plus possible de faire travailler des esclaves aux Etats-Unis, on peut encore faire cultiver aux colonisés, sur leurs propres terres, le coton dont l’Occident a encore besoin. Ce coton réputé de grande qualité car entièrement travaillé à la main. Entièrement travaillé à la main, car des familles toutes entières s’y collent, femmes et enfants compris. En effet, à partir de 1901, la France instaure dans ses colonies de l’AOF (Afrique occidentale française) et de l’AEF (Afrique équatoriale Française), un impôt dit de capitation. Au début, les indigènes (populations locales) devront s’en acquitter en coton. Débute alors la longue phase qui se poursuit encore, de la culture de ce qui sera appelé « l’or blanc » dans les pays ouest-africains. Mais cette culture exogène pratiquée de façon intensive depuis autant de décennies a lessivé les surfaces agricoles. Sur une bonne partie du Burkina, la plupart des terres n’arrivent même plus à faire pousser de la mauvaise herbe. Ce sont des terres appauvries, desséchées, n’étant plus que du caillou et surtout, n’absorbant plus l’eau pluvieuse. Sur ces terres, la pluie désormais ruisselle et s’en va. On les appelle les « zipéllés » qui signifie des clairières. Au Burkina aujourd’hui, les zippéllés constituent plus de la moitié des surfaces agricoles d’antan. Des terres qui ne sont plus bonnes qu’à la construction de maisons. Ce phénomène est un accélérateur certain de l’émigration de jeunes burkinabés, de jeunes Ouest-africains vers la France à tout prix… Lamine notre jeune fripier revend les vêtements qu’il achète à l’association Emmaüs. Il espère se payer la traversée en France avec les bénéfices faits sur la friperie. Balkissa, étudiante, fille de cotonculteur n’échappe pas non plus à la tentation de l’Europe. Elle aussi veut coute-que-coute y aller pour tenter d’y prendre aussi sa part du gâteau. Elle mène avec son groupe de copines étudiantes, la chasse aux visas… Sur internet comme dans les endroits stratégiques de la ville. Le terme visa ne désigne pas seulement l’estampille tant espérée sur une page de son passeport. Le terme désigne aussi et surtout l’homme dont la couleur du derme, la couleur du passeport, la couleur de la bite estampille d’une humanité supérieure, qui a la grâce d’obtenir mariage avec lui ou de porter son enfant… Le prix de la nationalité française ne passe pas toujours par les bateaux de migrants. Au pays des hommes dit « intègres », mais plus largement en Afrique de l’Ouest, on dit j’ai trouvé « mon visa » comme ailleurs, on dirait, j’ai rencontré quelqu’un… « Dans l'oubli de soi, quand le passage des multiples autres s'oublient en nous, il y a une forme de courage qui se teinte d'abnégation à l'endroit de qui l'on pourrait être ailleurs qu'à l’horizontal… » écrit Balkissa, dans les pages de son manuscrit. Ce journal intime, qui pourrait de l’avis de la réalisatrice que je suis, intéresser de sur 3 5
sérieuses maisons d’édition… Car Balkissa n’est pas juste une ambitieuse à la tête et au cœur vide. Dans l’intimité de sa chambre épurée, un matelas vétuste posé à même le sol, une valise contenant ses vêtements, un bidon d'eau, quelques outils et chaussures éparses constituent l'essentiel du mobilier. C’est dans ce décor minimaliste, face à un miroir fixé au mur que Balkissa les soirs, se farde de rouges à lèvres et autres maquillages avant d’enfourcher sa moto pour aller retrouver ses copines afin d’aller à la chasse aux visas. C’est dans l’intimité de ce relooking qu’elle aime à se confier. Peut-être dois-je dire qu’elle aime à jouer à l’intello face à la caméra ? Face à elle-même ? Faire étalage des poèmes qu’elle griffonne dans son journal intime, comme pour se rappeler qu’elle n’est pas qu’une chasseuse de visa, qu’elle est aussi autre chose. Depuis que Balkissa a entrepris d’échapper, de toutes ses forces, à la vie misérabiliste qu’elle a en partage avec les siens, elle ne voit plus dans ces hommes aux dermes différents qui l’ont traversé et continueront de la traverser que de simples palissades pour grimper, des ponts pour changer de monde… Et à celui qui est tenté de la juger de se rappeler qu’il ne sera légitime à le faire que quand il aura marché des kilomètres tous les soirs durant une enfance affamée pour trouver un lampadaire sous lequel apprendre ses leçons au milieu des voitures en circulation. Quand il l’aura fait, adolescent au collège, au lycée, à l’université pour décrocher un master en géographie qui ne fera qu’office de décoration sur un meuble inexistant d’une chambre vide, d’une vie vide… Alors Balkissa écrit, chasse le visa, nourrit son ressentiment contre un Occident qui n’a pas de visage pour elle mais qui la réduit à une sous humanité.
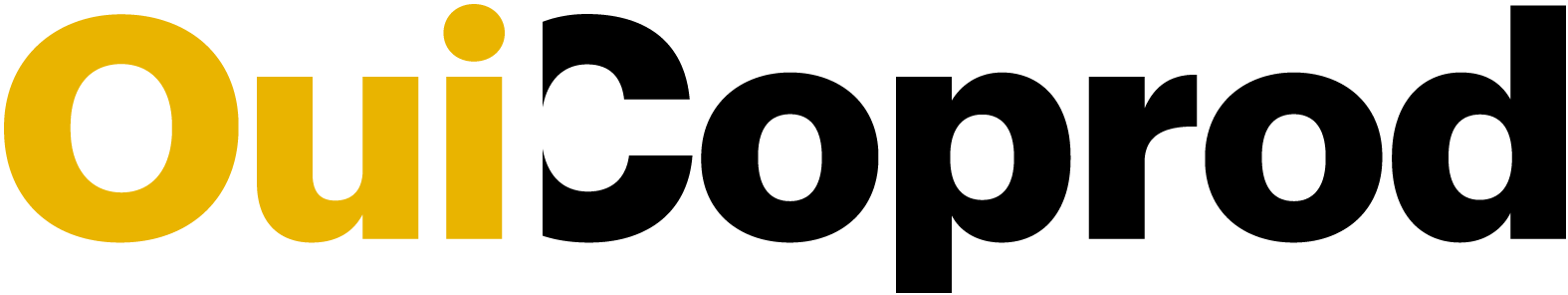


 Chloé Aïcha BORO
Chloé Aïcha BORO Productions Métissées
Productions Métissées.600x750-f.jpg) Zanatany - L'empreinte des linceuls esseulés
Zanatany - L'empreinte des linceuls esseulés .600x750-f.jpg) Dia, le prix du sang
Dia, le prix du sang Benimana
Benimana.600x750-f.png) La maison du vent
La maison du vent